
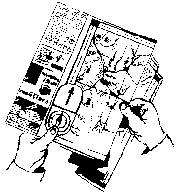

MEMO de stage
Club Alpin Français - 3 rue de l’Orient
31000 Toulouse
tel 05 61 63 74 42

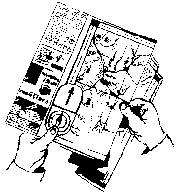

MEMO de stage
Club Alpin Français - 3 rue de l’Orient
31000 Toulouse
tel 05 61 63 74 42
Sommaire :
Exercice d’orientation sans
boussole
16. Les
quatre opérations principales
Mesure d’un azimut sur la carte
(OPE 1)
Report d’azimut sur le terrain (OPE
2)
Mesure d’un azimut sur le
terrain(OPE 3)
Report d’azimut sur la carte(OPE 4)
24. La
Visée et la Contre-visée
Liste des figures :
Introduction
Ce livret accompagne le stage de cartographie et d’orientation que le
Club Alpin Français de Toulouse à mis en place.
Il n’est donc qu’un support permettant de suivre ce stage et aussi, par
la suite, de revoir le contenu.
Aucune prétention n’est faite. Nous nous savons imparfaits et des
erreurs sont peut être encore présentes. Informez-nous afin d’apporter les
corrections nécessaires pour les prochaines sessions.
Cet ouvrage est le fruit d’un long travail. Les technologies
d’aujourd’hui permettent de le copier facilement.
N’hésitez surtout pas !
Thierry Chauffour
La carte est la projection symbolique et plane d’une zone réelle. Le globe terrestre est imaginairement découpé en zones. Chaque zone est projetée sur une surface plane : la carte. De part ce découpage et cette projection, il en résulte une déformation sur le plan. L’importance de cette déformation est fonction dépendante de la méthode de projection et de la trame de découpage.
La méthode Lambert utilise la projection sur un cône (fig. 1). L’axe de ce cône est le même que celui de la terre. Pour réduire la déformation, la superficie du globe est divisée en plusieurs parties (fig.2). Pour la France, il y a quatre zones : le nord, le centre le sud et la corse. Chaque plan est parallèle à la tangente de la surface.
|
Figure I‑1 |
Figure
I‑2 |
Pour conserver les proportions entre chaque point, cette zone est réduite uniformément dans chaque direction. Le taux de réduction est appelé: l’échelle . Il est écrit selon le format 1/X (exemple : 1 / 25 000) ou 1 : X (ex : 1 :25 000). Il existe plusieurs échelles, chacune répondant à une utilisation spécifique. Pour se déplacer en montagne on utilise communément les cartes à l’échelle 1/25000éme. Pour des longues traversées et pour éviter d’emporter trop de cartes, on peut être amené à utiliser les cartes au 1/50000éme (ceci au détriment de la précision).
Sur une carte au 1/25000éme, 1 mm représente 25 m. Pour connaître les distances réelles, il suffit de relever sur la carte la distance (par exemple 132 mm) et de la multiplier par l’échelle (1 / 25000) :
Ainsi : 132 mm X 25 000 = 3 300 000 mm
ou 3300 m
ou 3,3 km
Pour simplifier les calculs, il est préférable de mesurer la distance en mm et de la multiplier par 25 (pour les cartes au 1/25000éme) pour obtenir directement le résultat en m.
Inversement, si vous avez parcouru une distance connue (ex : 4,5 km) vous pouvez connaître sa longueur sur la carte. Il vous suffit de diviser la distance par l’échelle.
Ainsi : 4500 m / 25 000 =
0,18 m = 180 mm
Comme précédemment pour alléger le calcul, il vaut mieux prendre la distance en m et la diviser par 25 (pour les cartes au 1/25000éme) et avoir le résultat en mm.
Une règle graduée figure dans la légende. Elle peut être utilisée afin d’éviter des conversions fastidieuses , pour vérifier nos calculs ou comme gabarit (à l’aide d’une ficelle).
Pour connaître la distance parcourue, deux méthodes peuvent être utilisées.
1. Mesurez de la distance parcourue pour un pas, comptez le nombre de pas, effectuer la multiplication « distance du pas » X « nombre de pas ».
2. Comptez le temps passé pour parcourir la distance et multipliez-la par votre vitesse de progression. Plusieurs essais préalables sont nécessaires pour connaître sa propre vitesse. De plus, elle peu variée selon le relief et/ou vos compagnons de route (en moyenne, la vitesse est d'environ 5 km/h).
Pour donner une impression de relief, la zone est grisé afin de simuler une ombre donnée par un éclairage fictif. Ce dernier provient du coin supérieur gauche de la carte.
Ainsi, tous les versants orientés vers le haut et à gauche sont pleinement ensoleillés et les versants orientés vers le bas et à droite sont complètement ombrés. Les versants orientés vers le haut et à droite et les versants orientés vers le bas et à gauche ne sont que partiellement ombrés ou ensoleillés.
Bien qu’imprécise, cette indication peut s’avérer très utile.
Pour indiquer les différentes altitudes, on utilise des COURBES DE NIVEAUX. Elles représentent le contour du relief pour un niveau d’altitude précis (fig. 3). Chaque courbe illustre un seul et unique niveau. Elles symbolisent un empilement successif de coupes horizontales du relief à des hauteurs espacées régulièrement (fig.4). La retranscription sur la carte donne une succession de contour (fig.5).

Figure I‑3

Figure I‑4

Figure I‑5
Les courbes suivent exactement les contours. On peut retrouver les différents reliefs rencontrés sur le terrain (mamelon, croupe, crête, talweg, doline, col, ...)
Ce mode de représentation offre le double avantage d’être précis et explicite dans le rendu du relief.

Figure I‑6
Chaque niveau est distant du suivant et du précédent d’une hauteur constante. Cette distance de séparation de niveau est nommée équidistance. Elle n’a pas la même valeur selon l’échelle de la carte ; 10 m pour les cartes au 1 / 25000éme et 20 m pour les cartes au 1/50000éme.
Toutes les cinq courbes de niveau, il y a une courbe maîtresse. Donc l’écart entre courbes maîtresses est de 50 m pour les cartes au 1 / 25000éme et de 100m pour les cartes au 1/50000éme . Ainsi sur les cartes au 1/25000éme les courbes maîtresses sont : 1200, 1250, 1300, ... Ces courbes maîtresses sont dessinées d’un trait plus gras et comporte l’indication de l’altitude. Cette altitude est exprimée en mètre et est écrite en chiffre. Elle est toujours orientée vers le sommet ou vers le point culminant (fig.7).

Figure I‑7
ATTENTION :
* Des points particuliers sont également cotés (en mètre), dans ce cas, l’altitude inscrite n’est pas orientée vers le sommet mais l’inscription est orientée vers le nord. Ces points cotés représentent l’altitude exacte (ex : 1632 ) en ce point.
* Sur les cartes au 1 / 25000éme , on trouve des niveaux intermédiaires indiqués par des lignes discontinues. Leur équidistance est de 5 m. Ces courbes sont utilisées pour les zones de faible pente (plaines) ou pour des zones particulières. Pour les zones montagneuses, on évite de les utiliser afin de ne pas surcharger la carte.
Pour définir l’altitude exacte d’un point, il suffit de :
Trouver la courbe maîtresse la plus proche
Relever son altitude (ex : 1600)
Compter le nombre de courbes de niveau séparant votre point et la courbe maîtresse (ex : 3)
Multiplier ce nombre par la valeur de l’équidistance (ex : 3 X 10 m = 30 m)
Définir si votre point est en amont (au-dessus) ou en aval (au-dessous) de la courbe maîtresse
Si votre point est en amont, additionner l’altitude de la courbe maîtresse et la hauteur calculée du point (ex : 1600 + 30 = 1630 m )
Si votre point est en aval, soustraire la hauteur calculée du point de l’altitude de la courbe maîtresse (ex : 1600 - 30 = 1570 m )
La pente est le rapport entre la hauteur et la distance. Elle peut être exprimée en % ou degré.
Pente = Hauteur / Distance
Avec la représentation par courbes de niveau ; nous voyons que plus la pente est forte, plus les courbes sont rapprochées ; moins la pente est forte, moins les courbes sont rapprochées.
Pour les zones de forte pente, les courbes devraient être tellement rapprochées qu’elles se confondent. Dans ce cas, elles sont remplacées par un « rendu du terrain » ayant l’apparence d’une zone rocheuse. Ceci permet de se rendre compte d’un seul coup d’œil de la présence d’un danger potentiel.
Soit les points A et B définissant un relief pentu et régulier, mesurez la pente séparant ces deux points.
· Tracer la distance AB
· Calculer la hauteur séparant les points
· Convertir cette hauteur à l’échelle
· Tracer la hauteur convertie à partir du point B et perpendiculairement à la droite AB. On obtient une droite BC.
· Tracer la droite AC symbolisant la pente
· Mesurer à l’aide d’un rapporteur l’angle BAC. On obtient précisément l’angle de pente séparant les points AB.
· Sur la ligne AB, relever le nombre de courbes de niveau sur 1 cm. Sachant que chaque courbe par cm nous donne 4% de pente, multiplier le nombre de courbes par 4.
· Si la pente entre deux points n’est pas homogène, il est préférable de fractionner les mesures. Pour la deuxième méthode, on peut mesurer la distance, compter les courbes de niveau et trouver la moyenne de courbe par cm pour effectuer le calcul.
Avec les courbes de niveaux, on a donc la représentation du relief. Il nous faut maintenant savoir l’interpréter.
En montagne, le relief est rarement d’une géométrie constante. Ainsi entre deux points distants nous parcourons des pentes différentes. Pour en avoir une représentation la plus fidèle possible, il est préférable de la décomposer en plusieurs zones (chaque zone étant définie selon le type de pente, accentuée ou non).
On remarque que selon les pentes, la visibilité diffèrera aussi. Dans notre exemple (fig : 8), le randonneur A peut voir le sommet tandis que le randonneur B ne peut l’apercevoir.

Figure I‑8
Concrètement, cela se retrouve très facilement sur la carte (fig : 9). Il faut se souvenir que le rapprochement des courbes de niveau indique l’inclinaison de la pente. En analysant cette proximité, trajet par trajet (visuel pour notre exemple), on remarque que :

Figure I‑9
* Le trajet de « A » est composé d’une première partie aux courbes espacées (donc peu pentue) puis d’une zone aux courbes très proches (donc plus pentue)
* Le trajet de « B » a la combinaison inverse (une première partie aux courbes très proches puis d’une zone aux courbes espacées.
Chaque édifice, chaque construction artificielle sont des points remarquables. Leur nature fait qu’ils sont facilement repérables, mais pour permettre de les différencier sur la carte, ils sont représentés par un symbole.
Les voies d’accès ont plusieurs représentations possibles selon leur importance (route à 2 chaussées, ...) ou leur constitution (chemin forestier, ...).
Les points naturels sont également représentés selon une symbolique adéquate. Les points d’eau (lac, étangs, ...) et les écoulements (ruisseau, torrents, ...) sont colorés en bleu ( !).
ATTENTION :
* les petits ruisseaux sont dessinés par des lignes bleues discontinues
* les parcours de ski de randonnées sont également représentés en bleu (plus foncé).
Les zones végétales sont colorées en vert ( ! ) et comportent des symboles différents selon le type de végétation rencontrée (résineux, feuillus,...).
On définit les directions selon un découpage de la circonférence en 360° allant de dans le sens horaire.
Ainsi, l’angle « 1 » et l’angle « 2 » semblent être identiques. La mesure de l’angle défini entre la ligne verticale et la ligne horizontale nous donne 90°. La mesure de l’angle défini entre la ligne horizontale et la ligne verticale nous donne 270°.

Figure II‑1
Cette circonférence comporte quatre directions principales qui sont les points cardinaux : le Nord, l’Est, le Sud et l’Ouest. Ces points cardinaux sont séparés par 90° d’angle (360° / 4 = 90°). Le Nord est donc à la position 0° (ou 360°), l’Est est à 90° , le Sud à 180° et l’Ouest à 270°. De plus, on les symbolise par leur initiale en anglais : Nord (N), Est (E), Sud (S) et Ouest (W).
Entre ces directions principales, on a des directions secondaires (utilisant aussi la combinaison des lettres pour les désigner). Ces directions sont distantes des directions cardinales d’un angle de 45° (90° / 2 = 45°). L’axe situé entre le Nord et l’Est, appelé Nord-Est s’écrit NE; entre le Nord et l’Ouest, le Nord-Ouest (NW) ; entre le Sud et l’Est, le Sud-Est (SE) et entre le Sud et l’Ouest, le Sud-Ouest (SO).
Entre ces directions secondaires, on a des directions tertiaires utilisant la combinaison des lettres principales pour les désigner (NNE, ENE, ESE, SSE, SSW, WSW, WNW et NNW).
Les coordonnées géographiques utilisent deux références : l’équateur et le méridien de Greenwich. Le point M est situé à l’intersection d’un Parallèle et d’un Méridien.
Les méridiens sont des cercles fictifs passant par les pôles géographiques. L’angle défini entre le méridien de Greenwich et le méridien passant par M est la longitude. Sur les cartes au 1 / 25000 les longitudes sont exprimées en grades depuis le méridien de Paris et en degrés depuis le méridien de référence : Greenwich. Le rappel est écrit en bas de la carte, écriture bleu pour les degrés, écriture noire pour les grades. Les méridiens sont représentées par un trait noir fin sur les cartes.
Ne pas confondre : avec le quadrillage bleu (1 km x 1 km) tracé sur les cartes compatibles GPS.
Les Parallèles sont des cercles fictifs, parallèles à l’équateur, faisant le tour du globe. L’angle défini entre l’équateur et le parallèle passant par M est la latitude. Sur les cartes au 1 / 25000 les parallèles sont représentés par des lignes horizontales en trait noir fin, ils sont repérés en degré ou en grade à partir de l’équateur (latitude 0° à l’équateur).

Figure II‑2
Sur
de vieilles cartes les intersections de méridiens et de parallèles sont
représentés par des croix noires et fines. Sur les nouvelles cartes au
1 / 50000 ces indications ont disparues.
Comme on vient de le voir, des angles constants séparent les directions principales et secondaires.
En étendant les bras de chaque coté, on décrit un angle de 180° . Toujours avec les bras, on peut aisément retrouver un angle de 90° puis approximativement un angle de 45°. Un angle de 90° peut également être divisé en trois angles de 30°.
Maintenant, on a donc la possibilité de retrouver, sans instrument, des angles de 180°, 90°, 45° et 30° mais aussi des combinaisons d’angle (180° + 30° = 210°, ...).
Nous savons que le soleil se lève à l’Est et se couche à l’Ouest. De plus, il parcourt notre ciel en 24 heures avec son zénith en milieu de journée (13h en hiver et 14h en été).
Notre montre à aiguille parcourt sa circonférence en 12 heures. Donc pour chaque heure décrite par la petite aiguille de la montre, le soleil aura parcouru 2 heures.
En orientant la petite aiguille vers le soleil, on trouve le Sud entre l’heure du zénith (13h ou 14h) et la petite aiguille. En raison de la conception de l’instrument, l’erreur est de 10° à 15°.
Pour les adeptes du numérique, et donc dépourvus de petite aiguille, la méthode décrite peut s’appliquer après une préparation. Planter un bâton dans le sol. Son ombre projetée représente ainsi la direction du soleil mais aussi la petite aiguille de la montre. De cette aiguille tracer un cercle et marquer l’heure de zénith du soleil. Comme précédemment, la bissectrice nous indique le Sud.
Rappeler qu’un angle situé à gauche doit être compté toujours dans le sens horaire. Ainsi l’ouest est à 270° d’angle.
S’orienter vers le Nord donc 0° (vrai ou fictif). Tendre les bras dans le prolongement des épaules. On obtient donc les directions W (270°) (bras gauche) et E (90°) (bras droit). On peut recommencer l’exercice sans les bras.
Découper les portions NW et NE en trois pour obtenir des angles de 30°. Pour affiner les mesures on peut se servir du plat de la main ou le petit côté d’une carte pliée qui représentent environ 10° (le grand côté de la carte fait environ 25°).
Exécuter un triangle équilatéral:
A partir du point de départ, prendre une direction. Compter le nombre de pas réalisés, ce nombre sera notre référence de distance. A partir de ce second point , calculer un angle de 60° par rapport au trajet effectué. Parcourir la même distance pour obtenir un troisième point. Recommencer comme pour le second point (angle de 60° et même distance). On doit arriver approximativement au point de départ. Recommencer l’exercice afin de corriger les erreurs et d’affiner les perceptions.
Cet
exercice peut être réalisé avec un carré.
Par un beau soir et sous un ciel étoilé, l’orientation peut se faire à l’aide de
la lune. Cet astre nous indique soit l’Est soit l’Ouest selon sa position. Il
faut au préalable connaître dans quel quartier il se situe (1er,2ème,...).
Quand la lune est dans son premier quartier, le croissant regarde l’Est. Quand la lune est dans le dernier quartier, le croissant regarde l’Ouest.

Figure II‑3
Pour nous guider nous utilisons la carte comme un outil dont le référentiel est le terrain que nous parcourons. Cependant, il est obligatoire de positionner cet outil en phase avec sa référence qu’est le terrain. Si nous voulons suivre une route, nous devons savoir tracer cette route sur la carte et savoir lire la carte pour pouvoir suivre cette route sur le terrain.
La carte est la représentation d'une partie du globe. Celui-ci suit l’axe de la terre soit l’axe Nord-Sud. Les cartes sont donc orientées selon l’axe Nord-Sud. Le bord supérieur étant dirigé vers le Nord, le bord inférieur vers le Sud, le bord gauche vers l’Ouest et le bord droit vers l’Est.
Des lignes verticales régulièrement espacées indiquent l’axe Nord-Sud, des lignes horizontales régulièrement espacées indiquent l’axe Est-Ouest.
Connaissant le Nord (boussole, soleil, montre,...) il est facile d’orienter correctement la carte selon l’axe Nord-Sud et suivre les indications de la carte. On peut également, par soucis de rapidité, effectuer une orientation selon un autre axe (par exemple une route orientée E-W, on cherchera directement l’axe E-W).
Par manque d’instruments de mesure pour connaître le Nord ou pour faciliter, on peut être contraint à orienter la carte directement à l’aide du relief environnant (un édifice, un pont isolé,...). Il faut prendre un premier repère et définir sa direction soit par rapport à notre position soit par rapport à un deuxième point. Ensuite, faire correspondre exactement l’orientation du détail de la carte avec l’orientation du point repéré.
La terre a la particularité de se comporter comme un gros aimant. Cet aimant est donc entouré d’un champ magnétique ayant un pôle Nord et un pôle Sud. Cet axe Nord-Sud magnétique n’est pas invariable. Sa variation change chaque année (elle est indiquée dans la légende).
Le globe terrestre a un pôle Nord géographique et un pôle Sud géographique. Il tourne autour de cet axe Nord-Sud géographique
Cependant, ces deux axes ne sont pas identiques dans leur position réelle. Ils sont décalés l’un par rapport à l’autre. La différence entre le Nord Magnétique (NM) et le Nord Géographique (NG) est un angle appelé la déclinaison. Sur la figure précédente représentant la terre vue de dessus (page 10), en fonction de votre position : A, B ou C vous avez une déclinaison différente.

Figure II‑4
Lors de son utilisation écarter tout objet pouvant influer sur le champ magnétique environnant. Les boucles métalliques importantes, les baladeurs (!) et plus particulièrement en hiver avec le port de l’ARVA ou le piolet.
Pour son utilisation, placer horizontalement la boussole et attendre la stabilisation complète de l’aiguille.
La boussole est un i instrument de mesure très précis. Elle remplie deux fonctions principales:
· Indicateur magnétique
· Rapporteur d’angle
Petit à petit, la technologie progressant, cet instrument à été amélioré et possède d’autres fonctions secondaires mais utiles:
· Loupe
· Règle
· etc ...
L’aiguille suit automatiquement le champ magnétique terrestre et nous indique donc constamment le Nord. Pendant nos déplacements, elle subit tous nos mouvements. Il est donc nécessaire de la stabilisée avant d’effectuer toute lecture.
La boussole est utilisée en tant que rapporteur d’angle. Il suffit de positionner l’axe de l’aiguille sur le point A. Faire coïncider le bord latéral de la boussole avec la droite AC. Orienter le cadran afin que l’aiguille fictive puisse correspondre avec la droite AB. La lecture sur le cadran nous donne l’angle BAC.
La boussole est composée principalement d’une aiguille aimantée. Cette aiguille à une extrémité aimantée Nord et l’autre extrémité aimantée Sud. Elle est totalement libre sur son axe horizontal de rotation et suivra naturellement les lignes du champ magnétique terrestre. Son extrémité Nord est attirée vers le pôle Sud, et l’extrémité Sud orientée vers le Nord. Par commodité, nous appelons l’extrémité Nord la partie dirigée vers le Nord.
L’aiguille est enfermée dans un boîtier pivotant. Il comporte sur sa périphérie les points cardinaux indiqués par leur lettre, une graduation des angles en degré (pour ne pas surcharger les inscriptions, on ne reporte les degrés que de deux en deux) et une indication des angles (comme pour les graduations, on n’inscrit qu’une partie ; par exemple de 20° en 20°).
Au fond de ce boîtier, on trouve la schématisation d’une aiguille (l’aiguille fictive) et des lignes de rappel.
Son utilisation est principalement vouée à la précision de lecture d’une carte (et non pas pour jouer au Robinson pyromane).
Graduée de millimètre en millimètre, elle va nous permettre de mesurer une distance entre différents points et de mesurer la pente d’un relief.
Accessoirement, elle peut être utilisé pour des analyses botaniques ou géologiques.
Il s’agit d’une marque ou d’un indicateur situé sur le boîtier. Il permet de lire directement l’angle relevé.
Comme son nom l’indique, le viseur nous permet de viser. Ainsi on peut connaître assez précisément la direction entre notre point et un point éloigné.
Des modèles de boussole ne comportent pas de viseur. La visée se fera donc plus approximativement.
Il sert à effectuer une visée tout en conservant avec précision l’orientation donnée à la boussole. Il permet d’avoir une meilleure précision dans la visée et donc dans les mesures. Certaines boussoles en sont dépourvues mais restent utilisables (dans ce cas on perd de la précision).
L’angle de marche correspond à l’angle formé par la direction Nord-Sud et la direction de marche. Cet angle est aussi appelé AZIMUT.
Pour cette opération, il faut se servir de la boussole comme d’un rapporteur pour relever l’angle formé entre la direction Nord-Sud et la direction Point de départ- but à atteindre. On peut utiliser les lignes de rappel ou tracer de nouvelles lignes sur la carte. En cas d’incertitude, il vaut mieux vérifier la mesure par une seconde et les comparer. Noter au besoin cet azimut.
Quand on connaît l’azimut (OPE 1), il suffit de bien orienter la boussole (axe Nord-Sud) et de voir dans le viseur le point indiqué dans le prolongement de l’axe de la boussole.
A l’aide du viseur, orienter la boussole en direction du point à relever. Faire tourner le cadran de la boussole afin de faire coïncider l’aiguille de la boussole et l’aiguille du cadran. Lire l’angle indiqué par le cadran et l’index du boîtier, c’est l’azimut.
Avec la valeur connue de l'azimut, faire correspondre l’axe Nord-Sud de la carte avec l’aiguille du boîtier (ne pas tenir compte de l’aiguille de la boussole). Le côté latéral de la boussole nous indique l’orientation entre les deux points de relèvement de l’azimut.
En montagne, cet outil précieux est aussi important que la boussole.
C’est un instrument qui mesure la pression atmosphérique ambiante. Cette mesure est ensuite convertie en indication d’altitude.
RAPPEL : Il faut savoir que la pression atmosphérique varie selon les conditions météorologiques. Quand le beau temps arrive, la pression atmosphérique augmente; quand le temps se gâte, la pression atmosphérique diminue. Mais cette pression atmosphérique change aussi proportionnellement avec l’altitude.
ATTENTION : Lors d’un parcours nécessitant l’utilisation d’un altimètre, il est IMPÉRATIF:
· Régler altimètre dés le départ (altitude connue)
· Dés que l’on atteint une altitude connue (point côté, édifice, ...), recaler son altimètre.
· Après un arrêt prolongé, recaler son altimètre (une variation météo peut influer sur l’altitude indiquée).
Lorsque l’on est à altitude constante (marche sur le plat, arrêt, ...) la variation de l’indication correspond à une variation météorologique. Certains altimètres calculent cette variation pour donner une tendance météorologique. On peut également avoir une information, il suffit de rester à la même altitude et de relever les variations barométriques.
Il en existe deux catégories:
1. les altimètres mécaniques
2. les altimètres électroniques
Leur constitution est simple. Ils comportent un détecteur de type capsule anéroïde qui est sensible à la différence de pression extérieure. Cette capsule est reliée à un mécanisme d’amplification. Un système permet de pouvoir recaler la valeur initiale. Une aiguille, solidaire du mécanisme, se déplace sur un cadran. Ce cadran est gradué en mètre (pour l’altitude) et certains modèles ont également une graduation en mb (pour la pression atmosphérique).
La variation de pression induit une déformation de la capsule. Ceci fait déplacer le mécanisme qui l’amplifie et le transforme en mouvement rotatif. Ce mouvement entraîne l’aiguille. La lecture se fait directement.
De part leur conception, les altimètres mécaniques souffrent d’une manque de précision. La fiabilité, la sécurité de leur lecture et leur robustesse compensent ce manque. Il est toutefois recommandé de les étalonner une fois par an (la capsule subit des déformations).
Pression normale, altitude constante

Figure II‑5
Pression décroissante, altitude montante
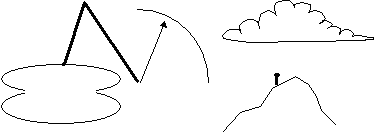
Figure II‑6
Pression croissante, altitude descendante

Figure II‑7
Plus complexes de part les composants les constituant, les altimètres électroniques sont basés sur le même principe. Des détecteurs (les senseurs) convertissent l’information de pression en une information micro-électronique. Un petit calculateur électronique analyse les lectures successives du (ou des) senseur(s) pour obtenir une information électronique. Cette information est directement inscrite sur un écran (à cristaux liquides généralement) en indication d’altitude et de pression.
Ces altimètres ont les avantages de la légèreté, du faible encombrement et d’une précision plus importante. Je vous rappelle que cette précision est tout à fait inutile si vous ne le recaler pas régulièrement. Un manque de fiabilité et de robustesse, plus un coût important ne sont pas négligeables.
Pour aller du point A au point B, l’évidence nous indique que le chemin le plus court est évidement la ligne droite. En montagne, le relief nous oblige parfois à devoir éviter u obstacle (falaise, ravin, barre rocheuse, ...).
Plusieurs méthodes peuvent être employées.
La façon la plus simple est (partant du point A) :
· Obliquer à angle droit (90°) sur la droite ou la gauche (le choix nous est souvent imposé lui aussi par le relief) (sens S1)
· Avancer droit devant en relevant la distance parcourue que nous appellerons D1 (point B)
· Après s’être écarté suffisamment, reprendre la direction initiale (donc pivoter à 90° dans le sens opposé au pivotement précédent, S2 )
· Après avoir totalement parcouru la distance correspondant à l’obstacle, effectuer de nouveau une rotation de 90° dans le sens S2 (point C)
· Parcourir en ligne droite la même distance d’évitement D1 (point E)
· Reprendre la direction initiale en pivotant une dernière fois de 90° dans le sens S1
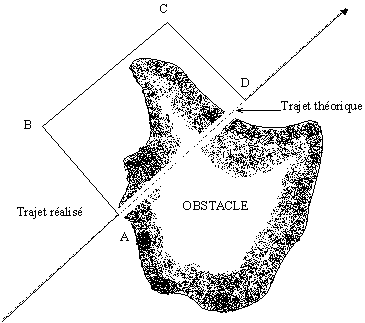
Figure II‑8
Pour éviter de parcourir trop de chemin, on peut également effectuer des changements de direction selon un angle plus ouvert (par exemple 60°).
Selon les zones rencontrées, la combinaison de différents angles peut s’avérer fort utile. Dans ce cas il faut non pas mesurer directement les distances parcourues pour l’évitement, mais calculer l’hypoténuse du parcours et effectuer la somme des trajets.. Mais ça devient beaucoup plus complexe !
Comme dans l’exemple précédent, nous sommes obligés de modifier nos trajets selon le relief. D’autres paramètres influent également sur le trajet (les conditions physiques des participants, les conditions météorologiques, les incidents, ...).
De plus la complexité de certaines zones rendent très difficiles la mémorisation et la lecture du parcours.
Pour nous simplifier la vie, il convient donc d’étudier préalablement notre parcours pour le décomposer en plusieurs parties.
Le début de notre tracé est le point de départ de notre parcours ! Puis chaque point essentiel devant être rencontré (par exemple: un pont, une arête, ...) doit être reporté.
La direction par rapport au point précédent est une information importante. Ensuite, les distances peuvent être inscrites soit en mètres soit en nombre de pas.
Les altitudes des points cotés et des édifices sont aussi à écrire.
Il faut tout de même se rappeler que ce tracé de parcours doit nous simplifier la compréhension de notre trajet. Il convient donc de ne pas trop le surcharger.
La difficulté des trajets et la complexité du relief peuvent nous amener à découper notre parcours en plusieurs tronçons. Chaque segment sera ainsi plus facile à étudier et la poursuite de notre itinéraire sera plus aisée.
Cette méthode est très vivement recommandée pour les parcours longs et difficiles, mais peut aussi s’appliquer pour des petits trajets.
Il s’agit de suivre les reliefs ou les zones faciles à suivre. Par exemple, au lieu de vouloir conserver un azimut constant, il sera plus reposant de suivre un cours d’eau ou la lisière d’un bois. La mise en oeuvre de cette méthode repose sur le principe de recherche de directions déjà existantes (lignes électriques, rivière, ...) afin de ne pas avoir à suivre des azimuts qui ne sont que des directions fictives.
Cette méthode consiste à suivre une altitude (plus précisément à marcher constamment à la même altitude).
Une fois l’altitude du point de départ précisément connue , il suffit d’évoluer tout en veillant à conserver l’altitude.
Afin de pouvoir recaler l’altimètre, on peut être amené à modifier quelque peu notre trajet pour rejoindre des points remarquables (dont l’altitude est précisée) ou des points cotés.
Par faible visibilité, l’orientation peut s’avérer difficile, surtout si l’on doit suivre un azimut.
Pour palier à ces conditions (la prochaine fois je prendrais la météo), cette technique se déroule selon le principe suivant :
· un premier participant (« A ») vise un point selon l’azimut calculé
· un deuxième participant (« B ») s’avance approximativement dans cette direction
· à chaque progression, « A » indique si « B » doit aller plus à gauche ou plus à droite afin que « B » conserve l’azimut (visé par « A »)
· dés que « B » commence à être moins facilement visible, « A » lui ordonne de s’arrêter
· pour confirmer, « B » peut effectuer une contre-visée (voir § suivant)
· « A » rejoint ensuite « B »
· recommencer ainsi de suite, ...
On peut aussi laisser traîner derrière soit un brin de corde pour indiquer notre azimut.

Figure III‑1

Figure III‑2

Figure III‑3
Une autre méthode, utilisée par mauvaise visibilité, est la visée/contre-visée. Elle permet de conserver un azimut. Pour l’utiliser, il faut donc savoir où on est et où on va ce qui nous permet de définir une direction.
· En utilisant l’azimut relevé sur la carte, du point de départ (1), viser un point (2).
· Avancer jusqu’à ce point (2).
· De ce point (2), viser le point (1).
· Vérifier que la boussole indique le contre-azimut du point (1). Le contre azimut est égale à la somme de l’azimut + 180°.
· Cette contre-visée effectuée, rechercher un point (3) et continuer à chaque point de faire la contre-visée.

Figure III‑4
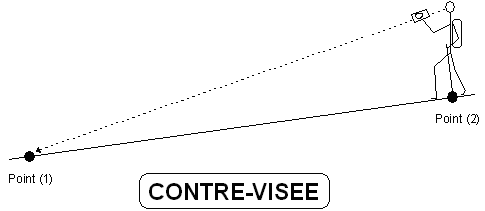
Figure III‑5
Par mauvaise visibilité, un refuge à atteindre peut s’avérer difficile. Si on décide de suivre correctement l’azimut, le cumul des erreurs (erreur de lecture de carte, d’interprétation de la boussole, de maintien d’azimut,...) peut nous entraîner plus à droite ou plus à gauche de l’objectif.
Pour vous donner une idée, le tableau suivant indique l’erreur en m pour une distance parcourue d’un km en fonction de l’erreur de visée en degré.
|
1° |
2° |
4° |
6° |
8° |
10° |
12° |
14° |
|
17 m |
35 m |
70 m |
105 m |
140 m |
176 m |
212 m |
249 m |
Pour éviter ce désagrément, effectuer une erreur volontaire. N’étant pas sur de pouvoir suivre exactement mon azimut, je dévie intentionnellement mon angle de marche.
Ainsi, au lieu de suivre l’azimut calculé, je m’oriente sur un des côtés de mon parcours idéal pour trouver un nouveau point. De ce point je pourrais prendre une direction facile me permettant de rejoindre mon objectif initial.
Dans l’exemple ci-après, je désire rejoindre le refuge. Plutôt que de suivre le parcours idéal, je choisis une autre direction. Ici nous choisissons le milieu de la paroi pour atteindre la partie inférieure de cette montagne (le point A). De ce point, il ne me reste plus qu’à suivre le bas de la paroi pour rejoindre (enfin !) le refuge.

Figure III‑6
La triangulation permet de pouvoir se localiser lorsqu’on est perdu ou pour confirmer une position.
Pour effectuer une triangulation, il faut pouvoir reconnaître trois points remarquables (sommet, église, village, ...).
Pour avoir une bonne précision, il est recommandé de choisir des points remarquables avec un angle de 120° (environ).
· Mesurer l’azimut du premier point.
· Sur la carte, repérer le point et tracer la direction relevée.
· Effectuer de même avec les deux autres points.
· L’intersection des trois directions nous donne un triangle, appelé « triangle d’incertitude ».
· Notre position exacte est comprise à l’intérieur de ce triangle

Figure III‑7
Rappel: toute courbe définie en un point donné une tangente.
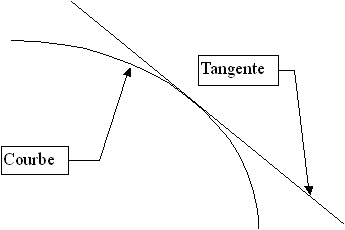
Figure III‑8
Comme pour la triangulation, cette technique va nous permettre soit de nous localiser soit de confirmer une localisation.
Très pratique pour le ski alpinisme, on peut néanmoins l’utiliser sans skis. Le principe consiste à se placer perpendiculairement à l’axe de pente. En ski, il suffit de ne plus avoir tendance à glisser vers le bas. On se trouve donc sur l’axe de la tangente à la courbe.
Deux mesures seront nécessaires. La mesure de la direction de cet axe (l’azimut de la tangente) et la mesure de notre altitude. Connaissant ces deux données, il faut alors rechercher sur la carte une courbe ayant la même altitude et dont la tangente a la même direction.
· Rechercher la position de la tangente à la courbe
· Mesurer l’altitude
· Mesurer l’azimut
· Sans dérégler la boussole, rechercher sur la carte les courbes de niveaux ayant la même altitude et le même azimut
Il
arrive parfois que plusieurs courbes répondent à ces deux conditions. Dans ce
cas, lever le doute à l’aide d’une autre technique simple (point
remarquable,...)
Par faible visibilité, la recherche d’un itinéraire peut s’avérer difficile.
La technique du sifflet consiste à palier au manque de visibilité par un signal auditif.
Il faut tout d’abord définir un premier de course.
· Celui-ci part du point « A » en progressant lentement.
· Le premier doit parcourir une distance moyenne ( à évaluer selon le terrain )
· Il s’arrête au point « B »
· Puis il signale au groupe sa position à l’aide du sifflet.
· Le signal sera émit jusqu’à l’arrivée du dernier participant.
· Recommencer ainsi pour tout le trajet sans visibilité.
ATTENTION: Le signal de détresse correspond à 3 coups suivis d’un temps d’arrêt ! Éviter d’indiquer votre position selon ce code.
Avant de commencer, il convient de se mettre d’accord sur le code utiliser. Par exemple quatre coups pour indiquer l’arrivée.
Les autres participants doivent également être munis de sifflet. En cas d’égarement, un code préétabli pourra être utilisé pour signaler sa position.
Selon les conditions on peut être obligé de changer ou de modifier notre itinéraire. Les stratégies différeront en fonction du moment et des possibilités. Voici quelques recommandations pour vous aider.
Avant de partir :
· définir un chef de course
· étudier le parcours (points remarquables, pentes, ...)
· définir des zones de repos
· définir des itinéraires secondaires et des rechappes (itinéraires de secours)
· établir une stratégie de départ
Par
mauvais temps :
Il faut se souvenir que :
· le brouillard fausse l’appréciation de distance et du temps écoulé.
· en hiver, la neige modifie le relief et la perception des distances
· dés l’apparition ou lors de la montée du brouillard, il est impératif d’effectuer une recherche de position afin de se localiser le plus justement et le plus précisément possible (tant que la visibilité le permet)
Pendant le parcours :
· savoir sur quel versant on se situe
· connaître sa position pour pouvoir se localiser
· vérifier régulièrement sa position
· estimer le temps de parcours ou la distance
Conduite de groupe :
· la conduite d’un groupe est fonction des capacités de l’élément le plus faible.
· éviter de dissocier le groupe
· en cas d’hésitation de route, le chef de course doit écouter tous ceux qui veulent s’exprimer et doit définir une stratégie
En cas d’égarement :
· la recherche d’une zone abritée ou la construction d’un abri (igloo, ...)peut rassurer et occuper le groupe(cela empêche d’avoir des pensées négatives)
· dans une vallée chercher une clôture et la suivre car elle doit mener à une zone habitée. Méthode à éviter en montagne.
· en cas de doute, ne pas hésiter à s’arrêter afin de « faire le point ».
· l’utilisation combinée de plusieurs méthodes nous permettra de confirmer ou de corriger notre trajectoire.
|
|
|
Et maintenant ...
bon courage !